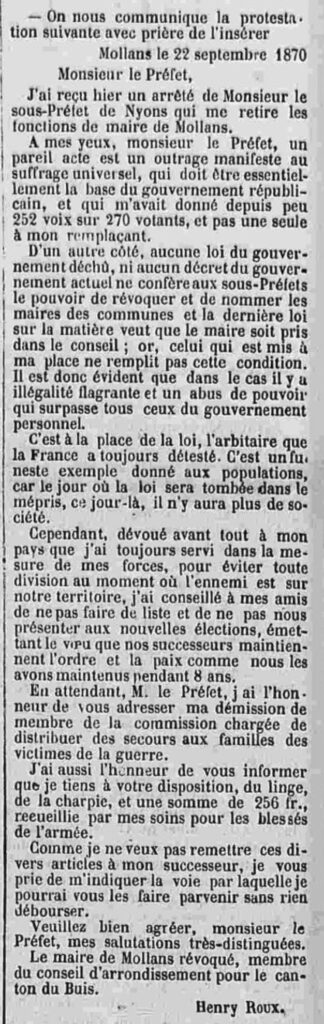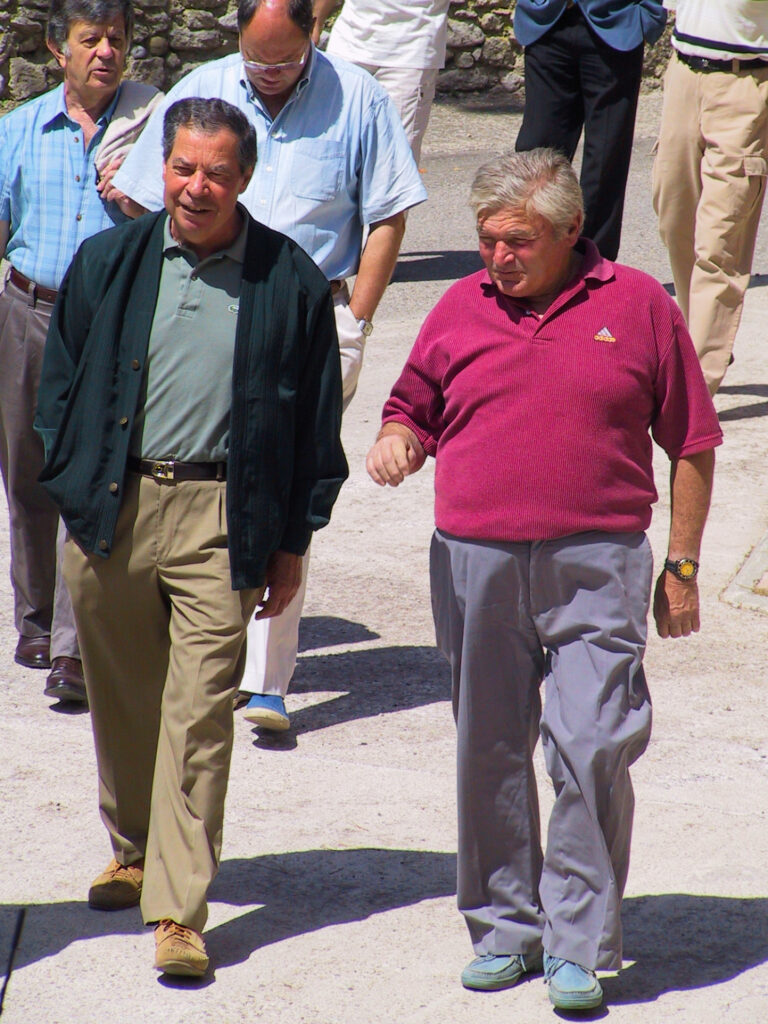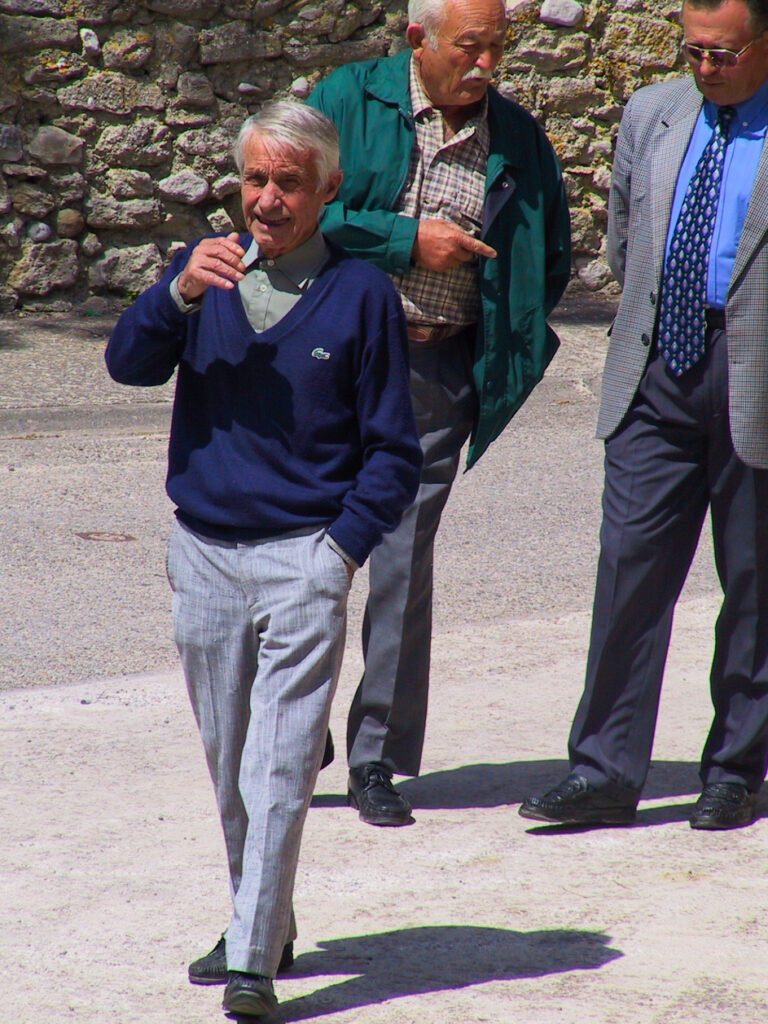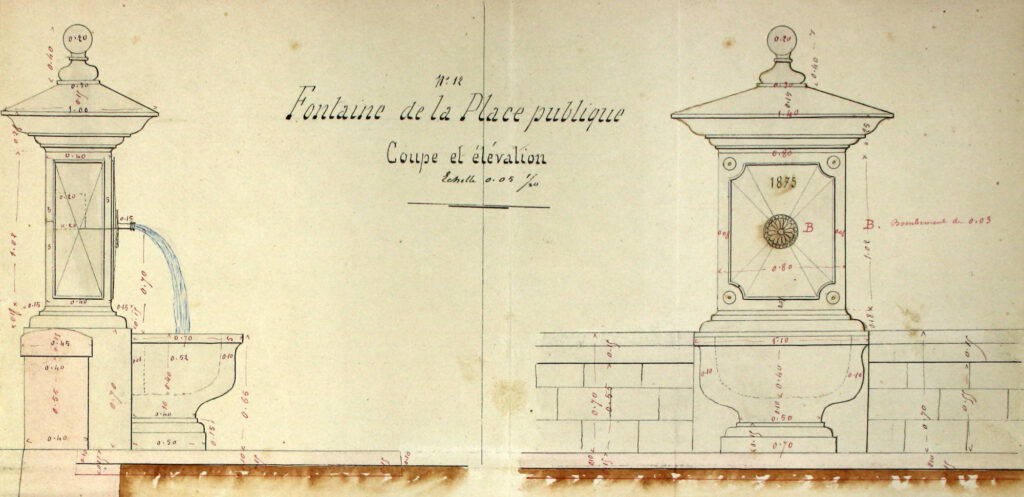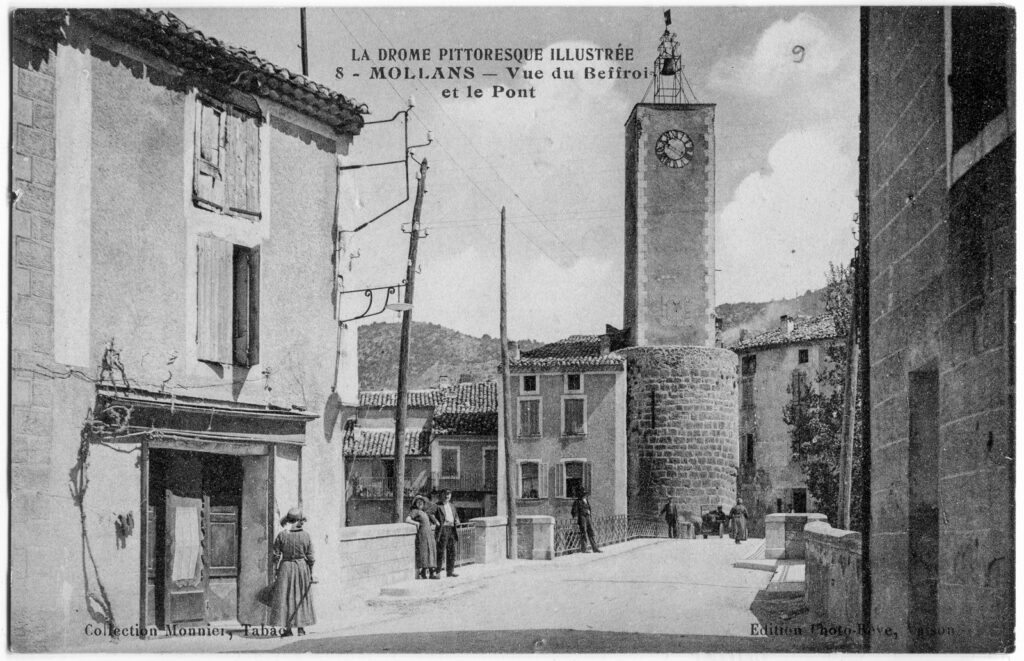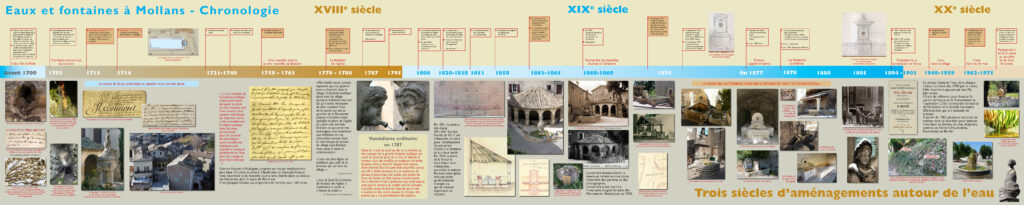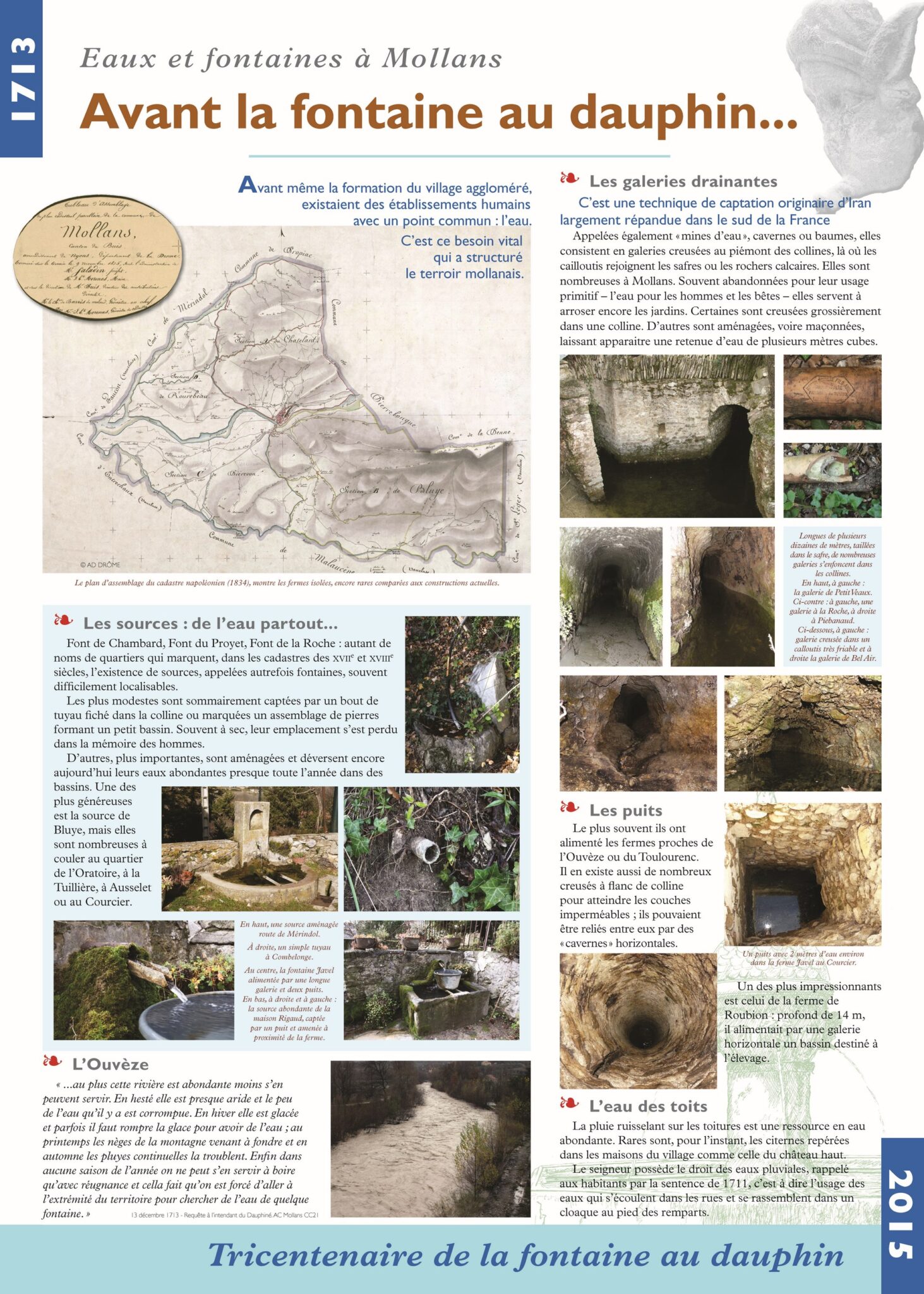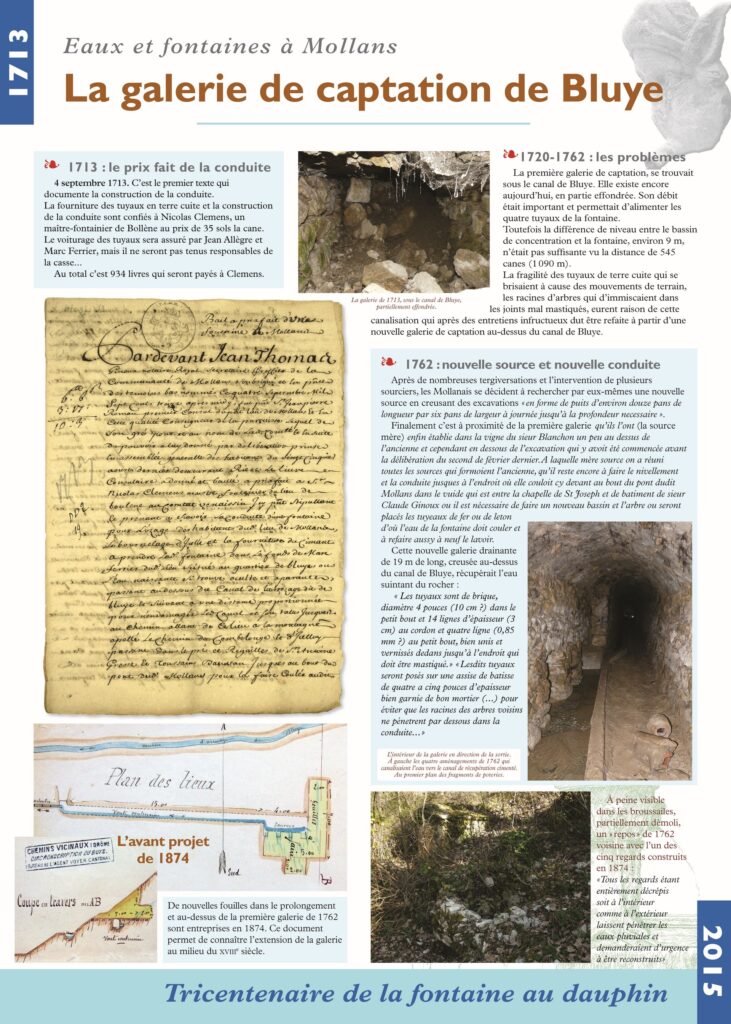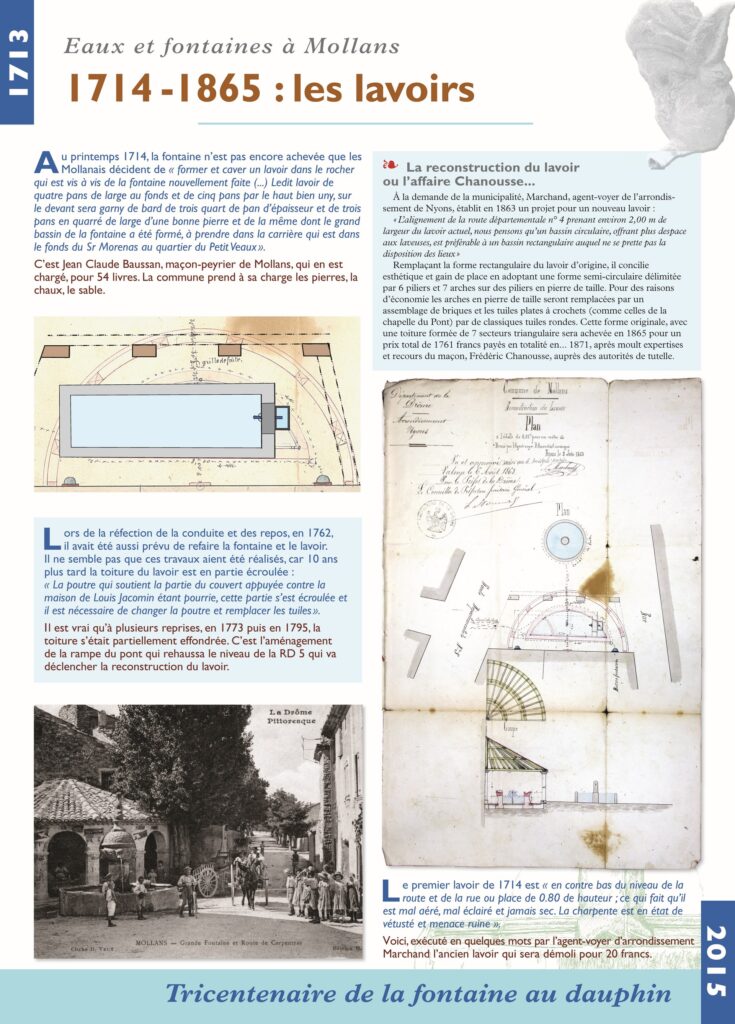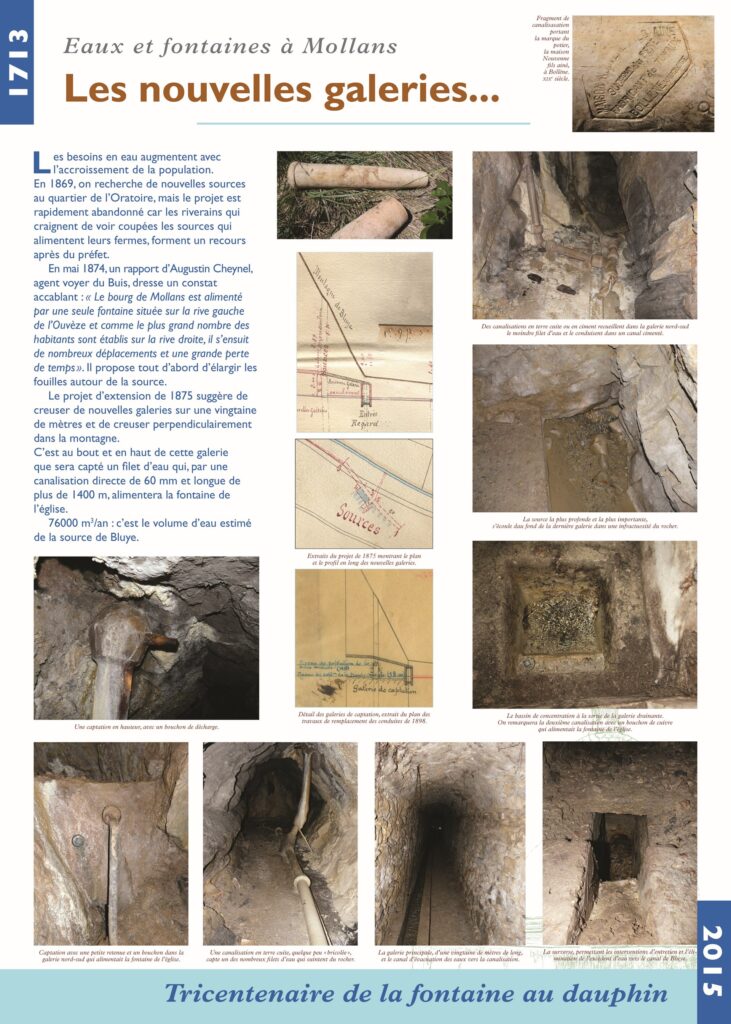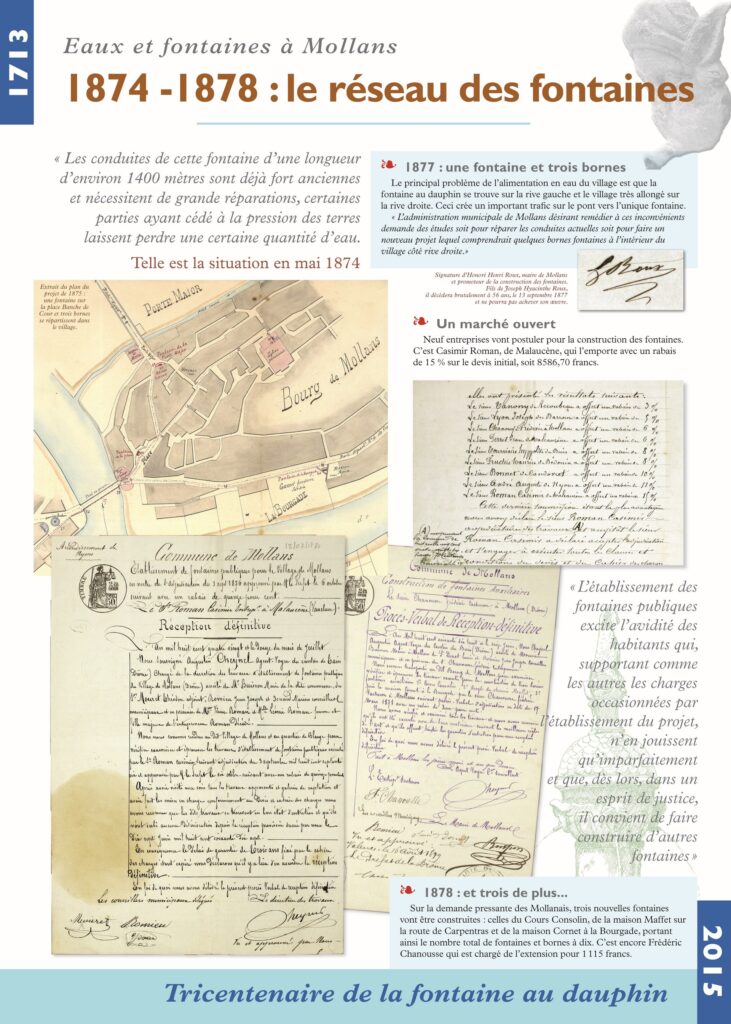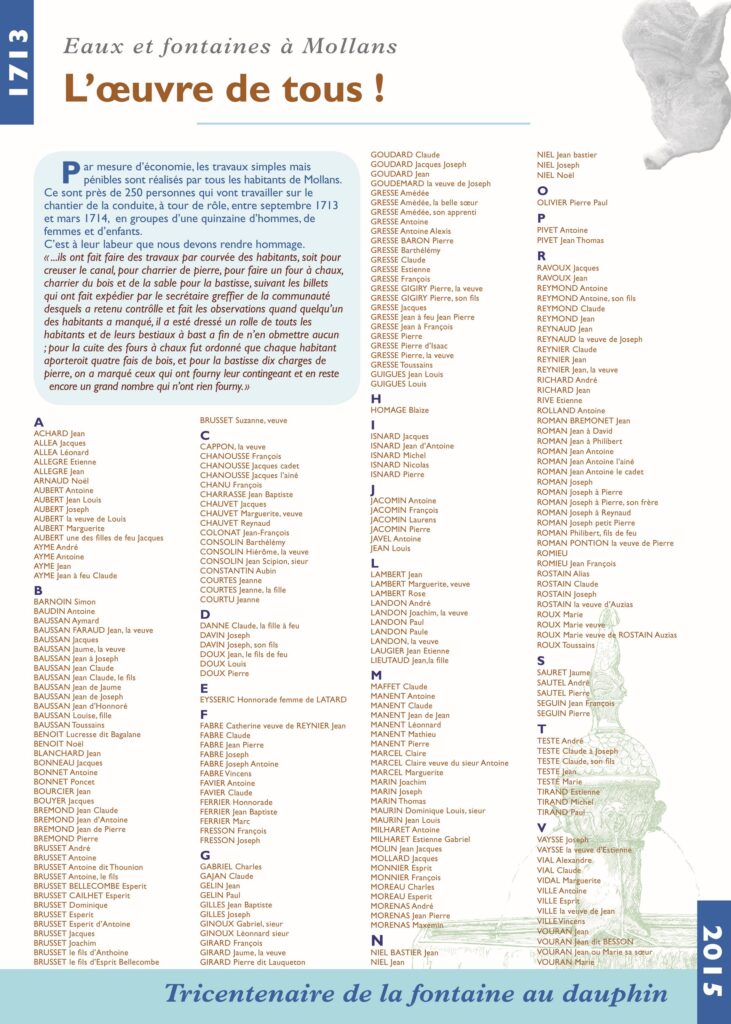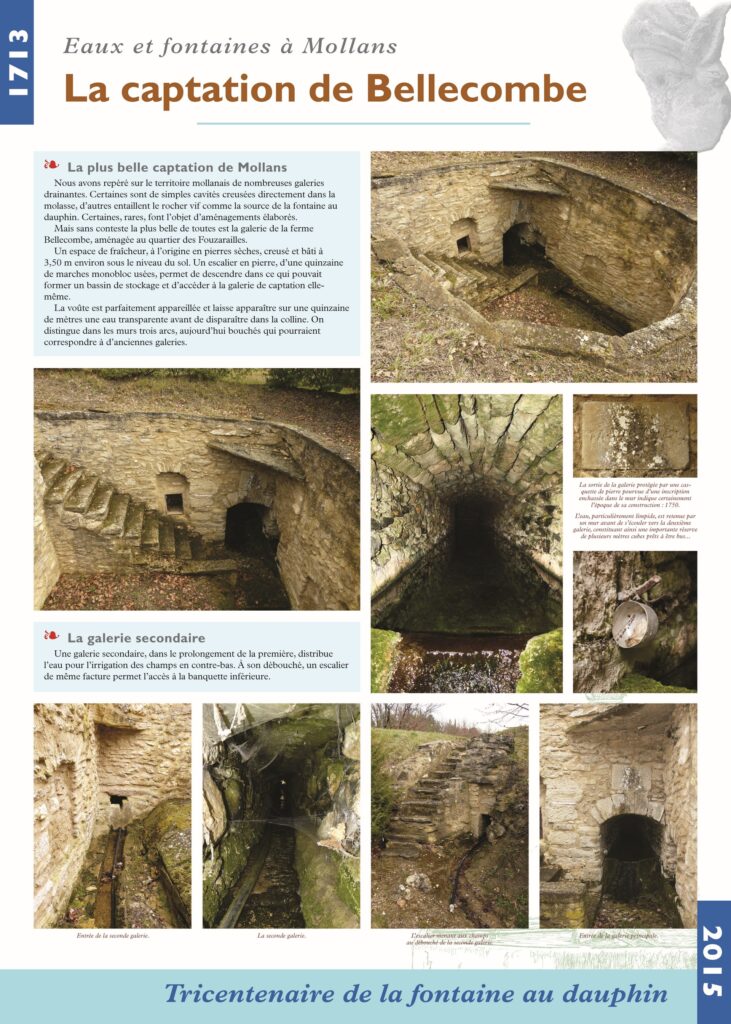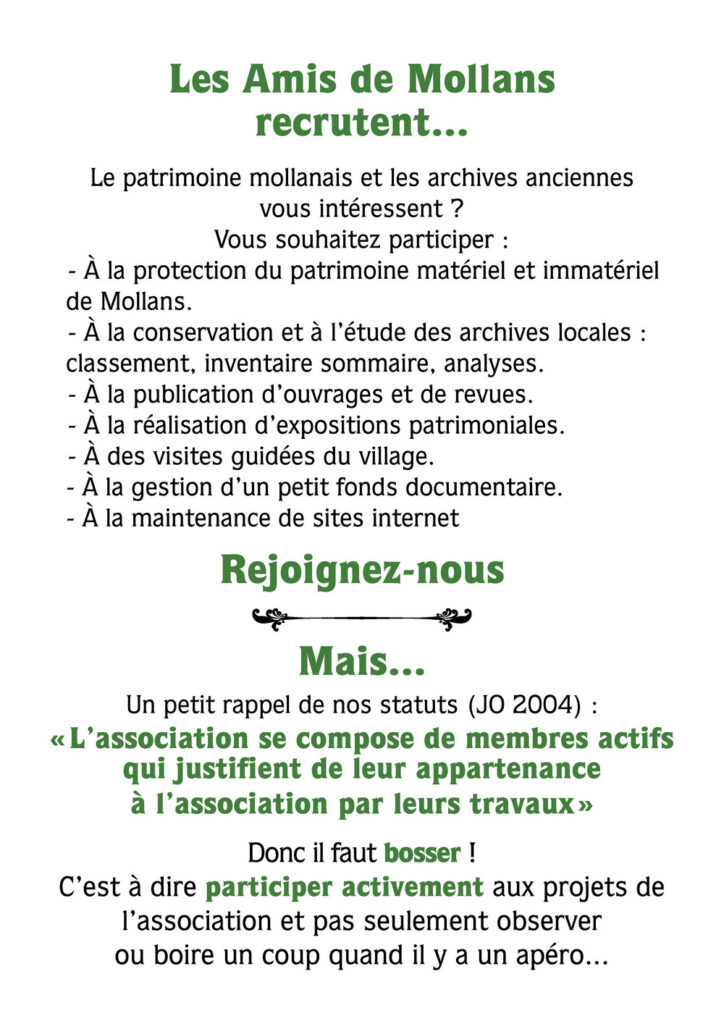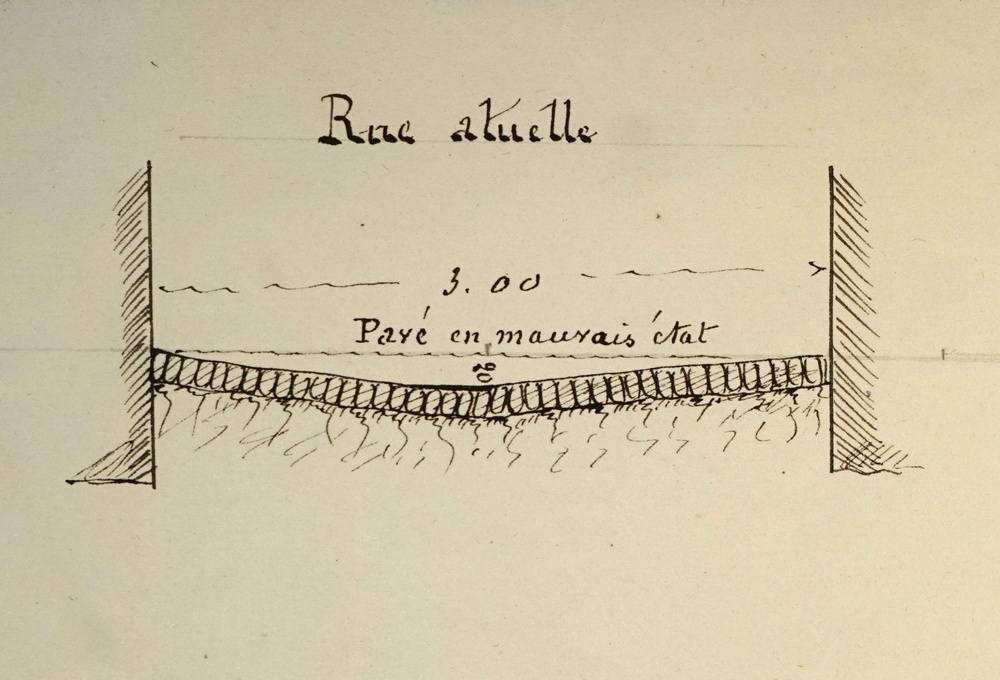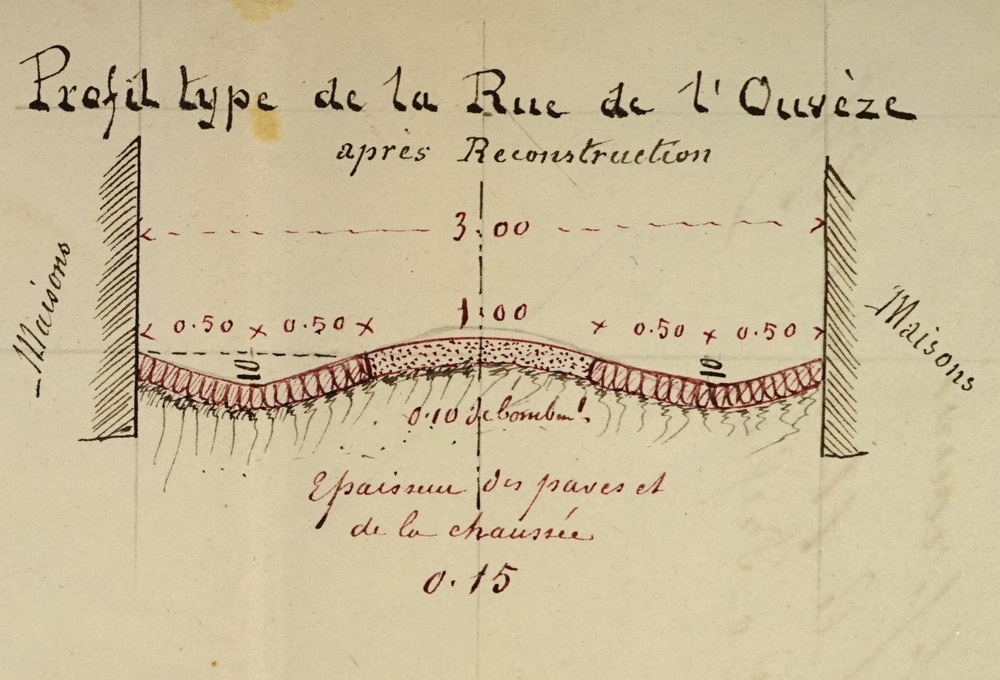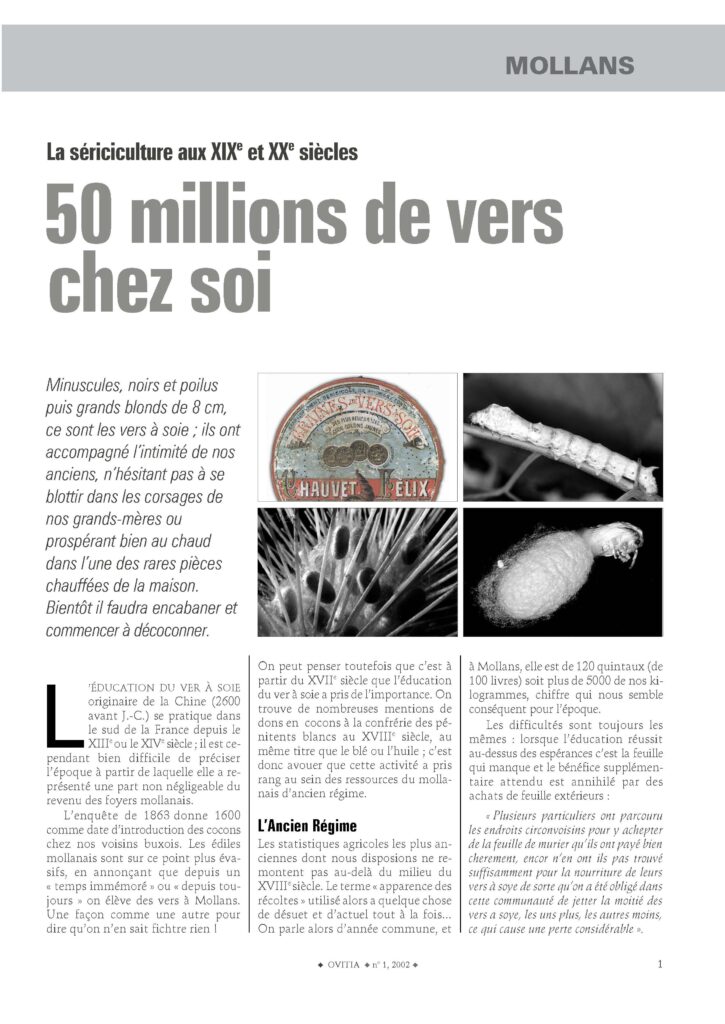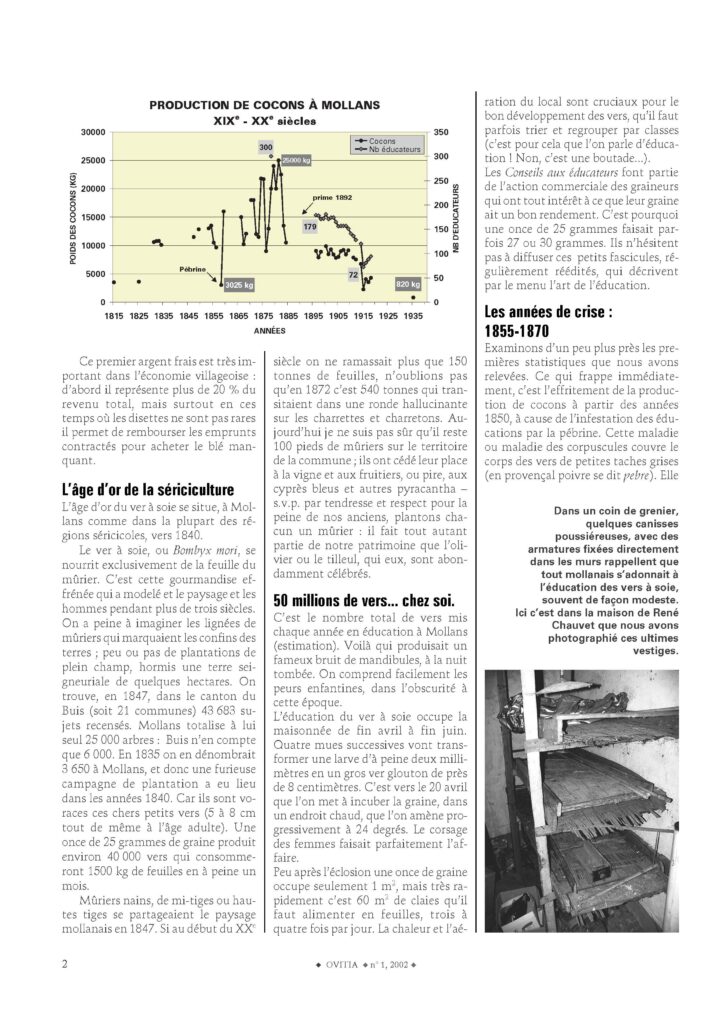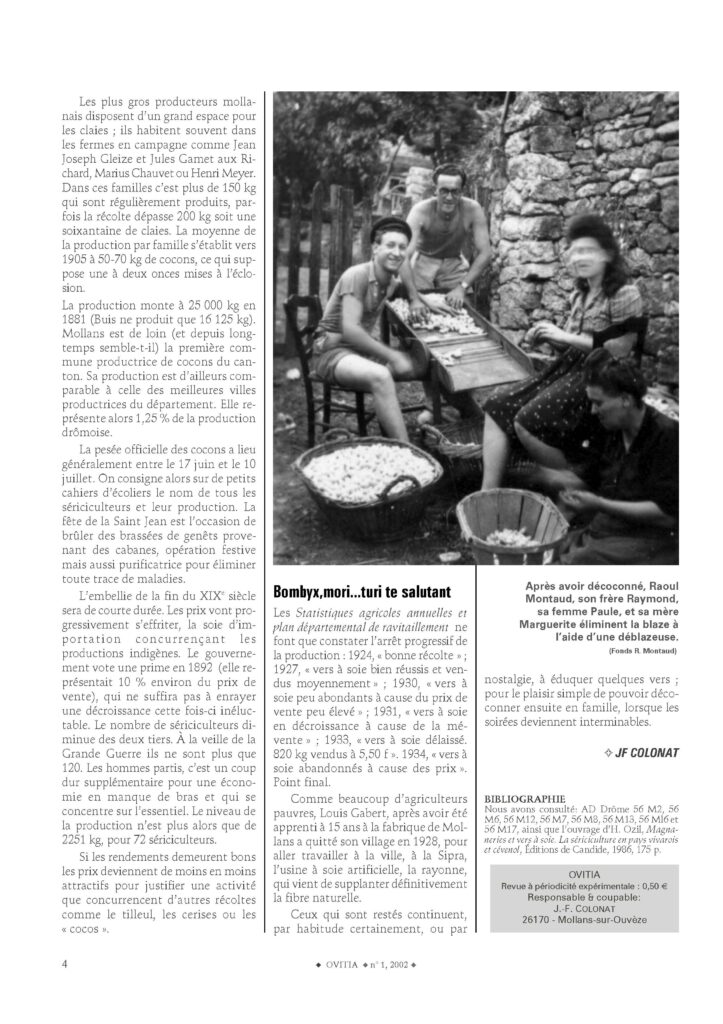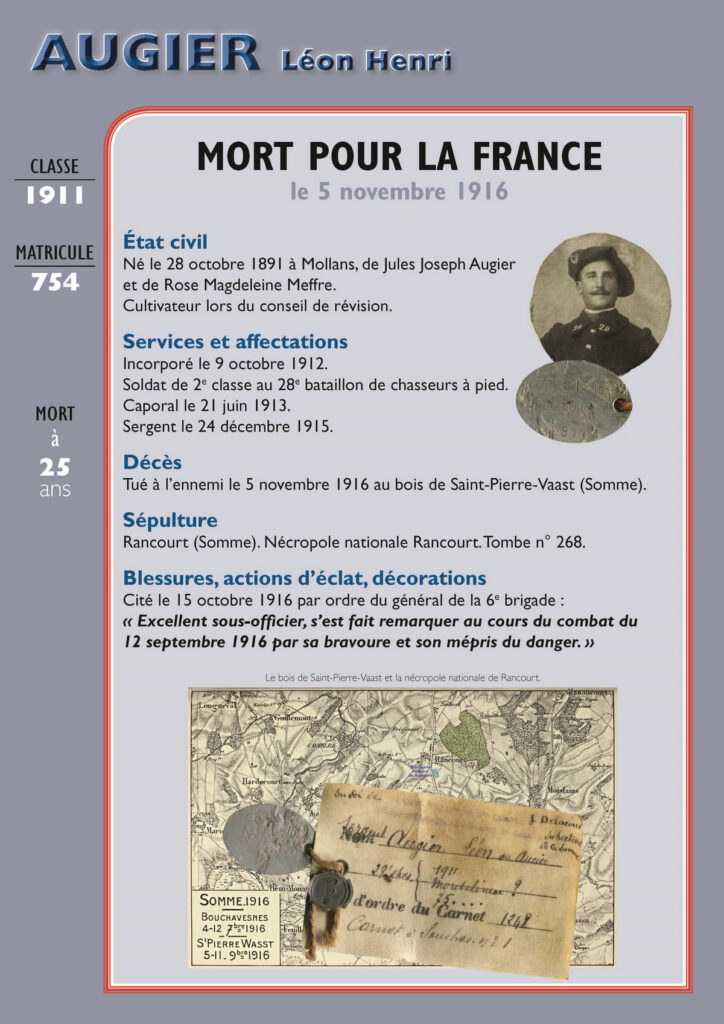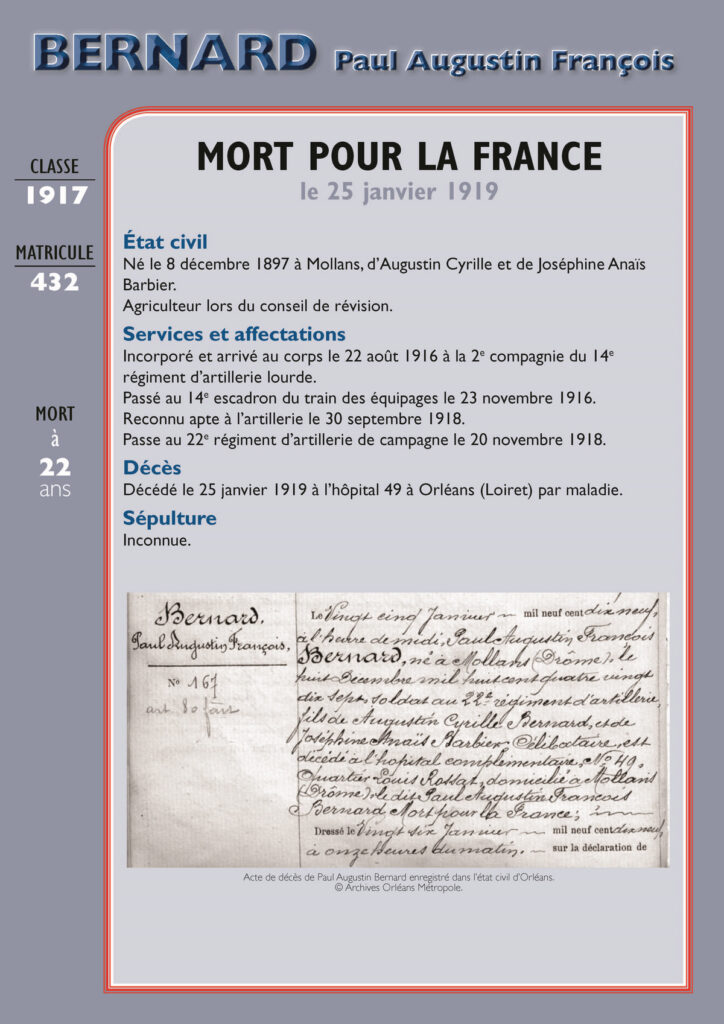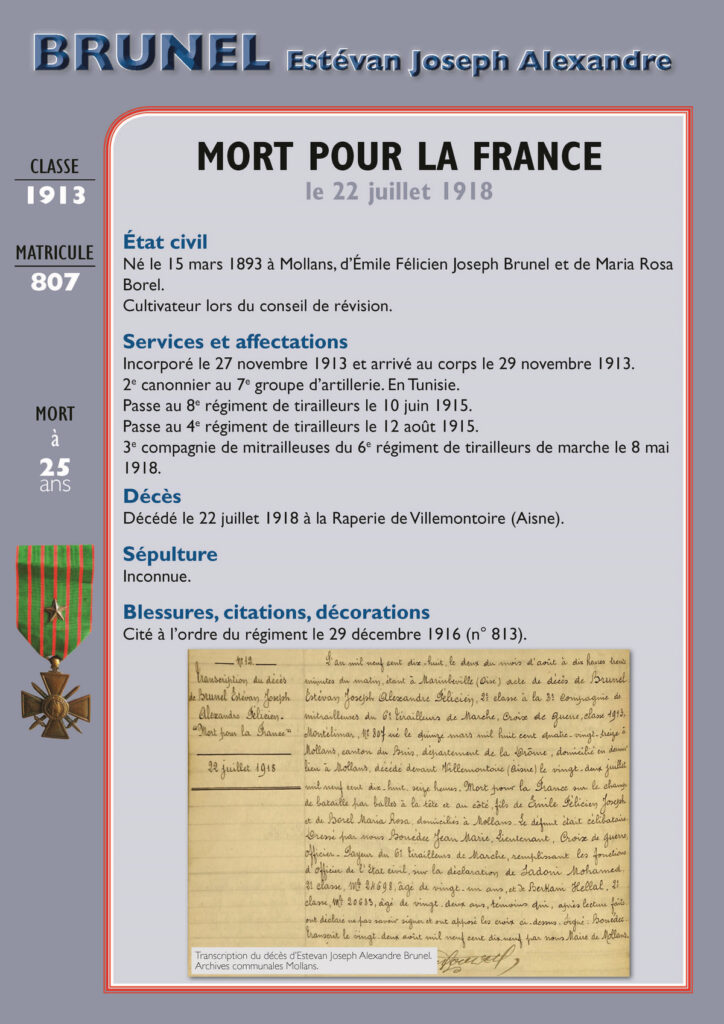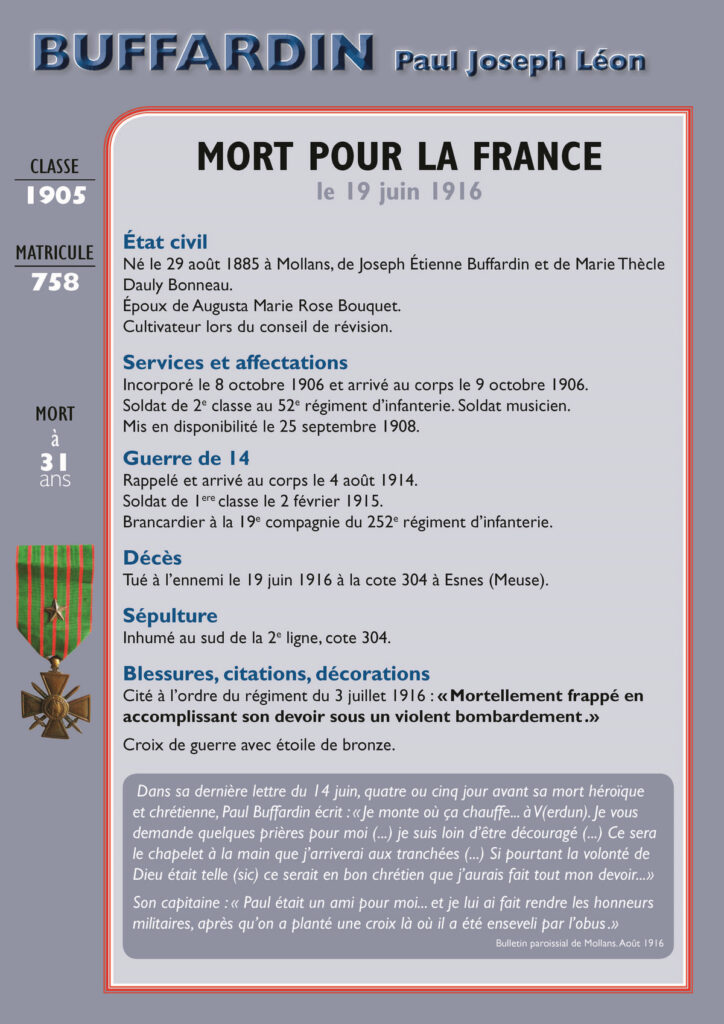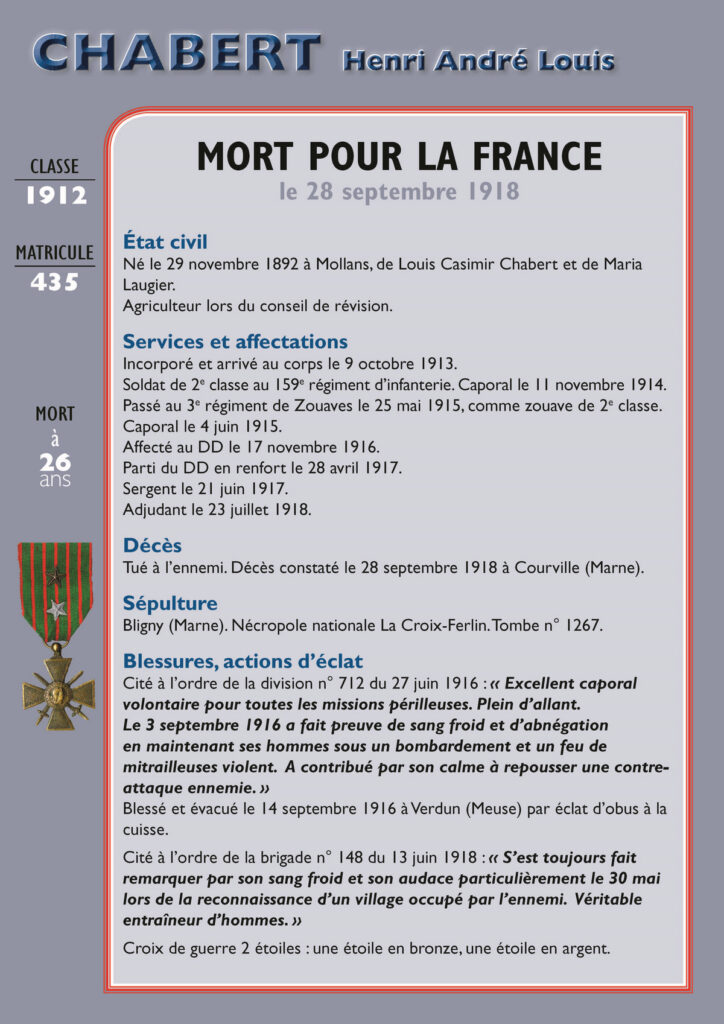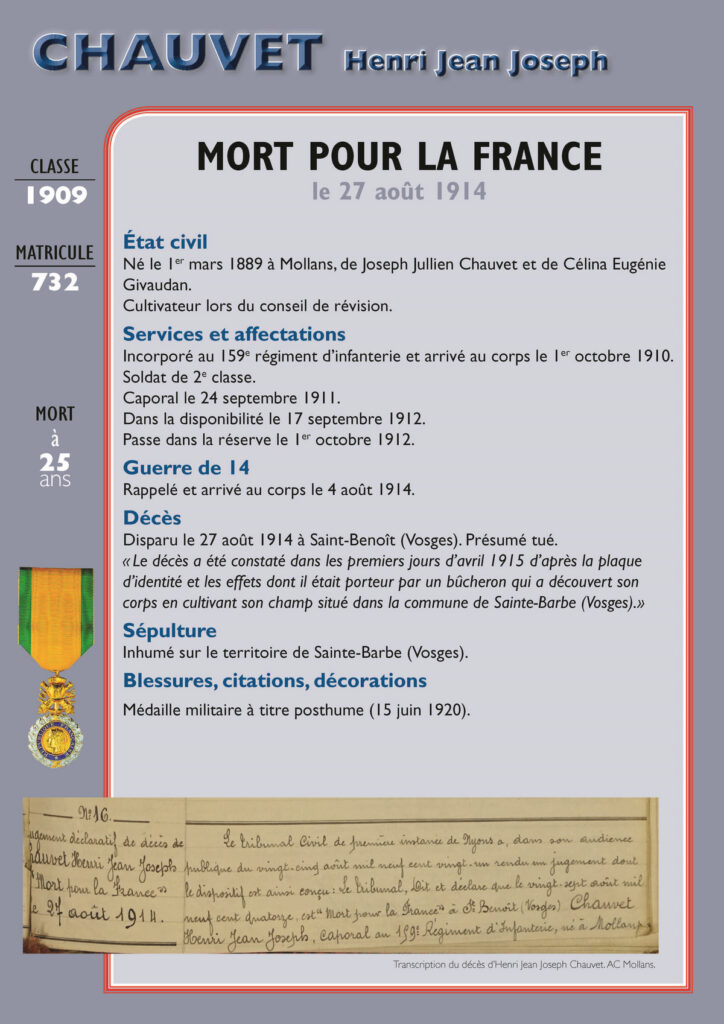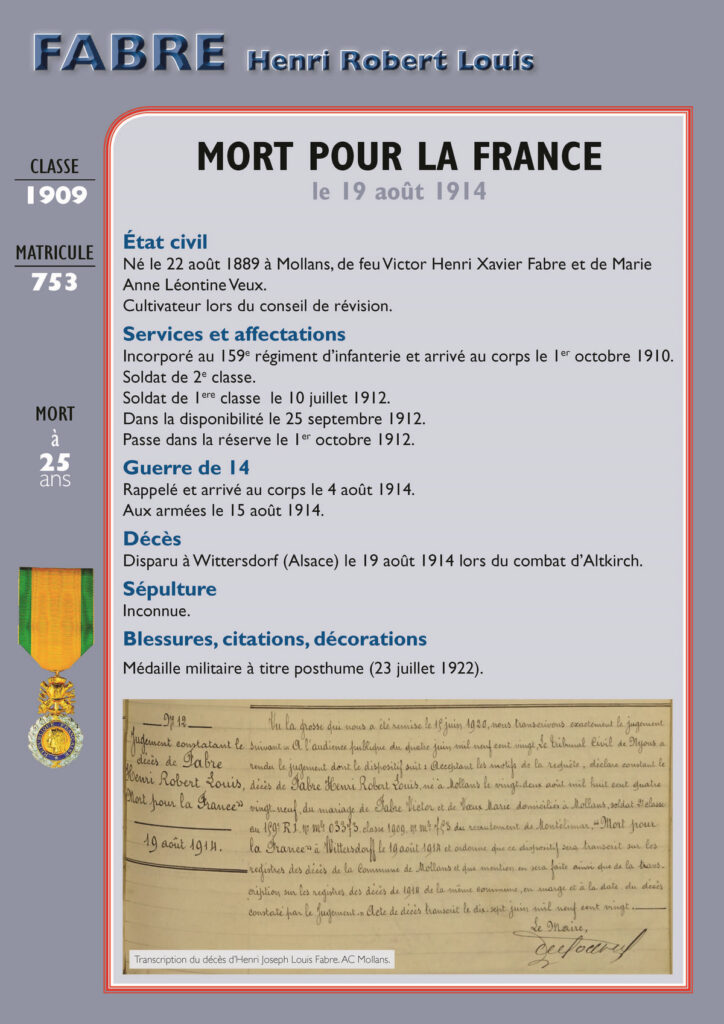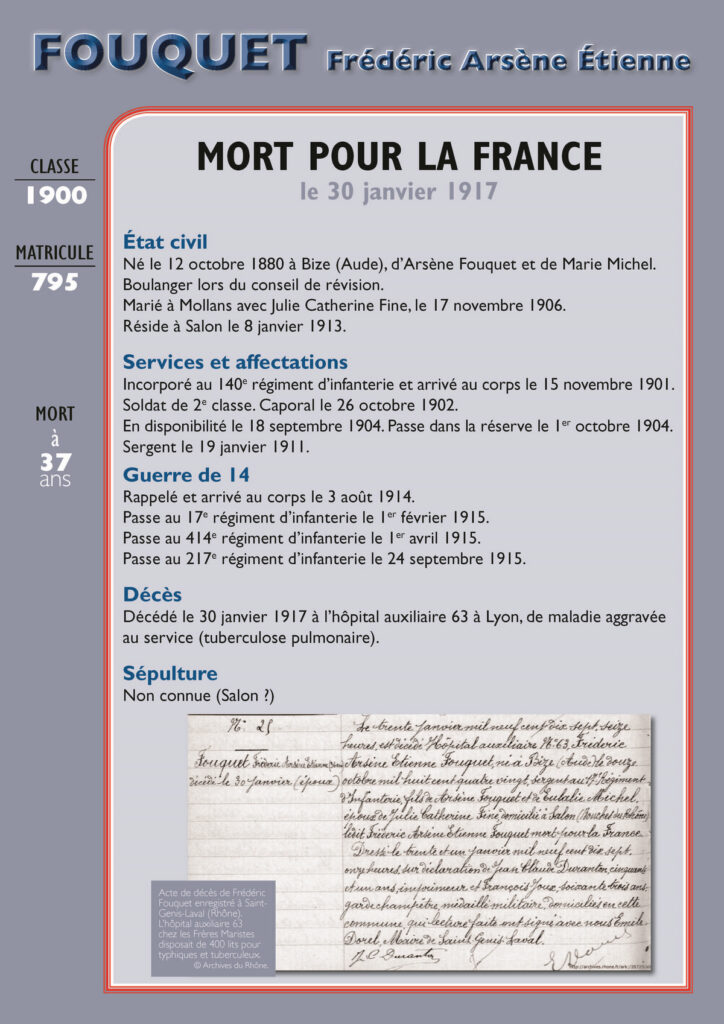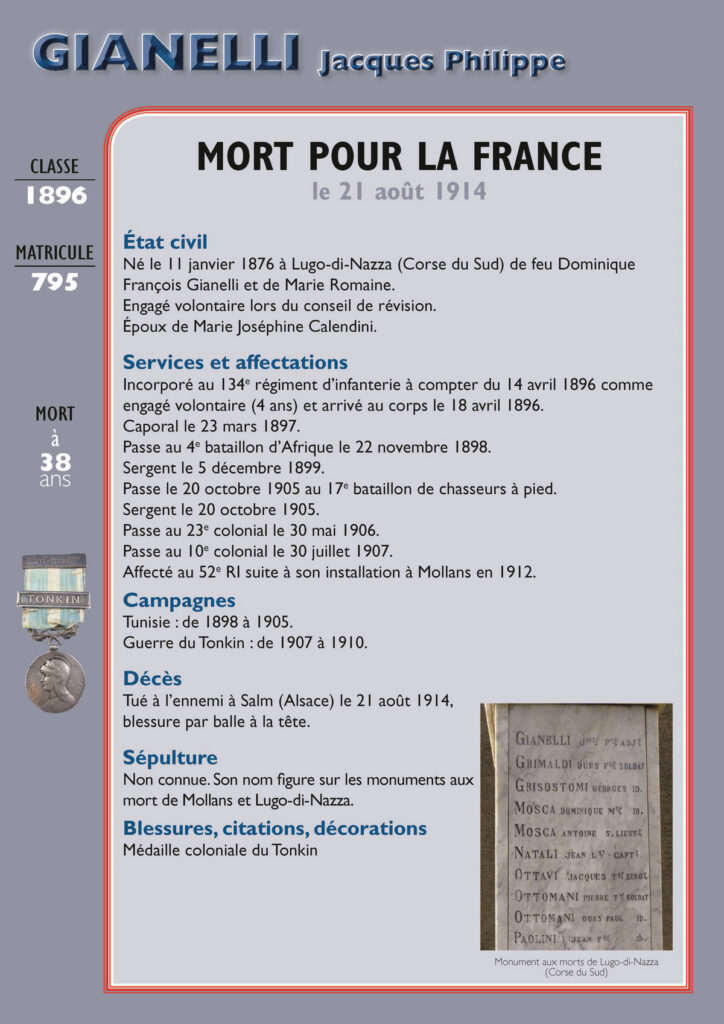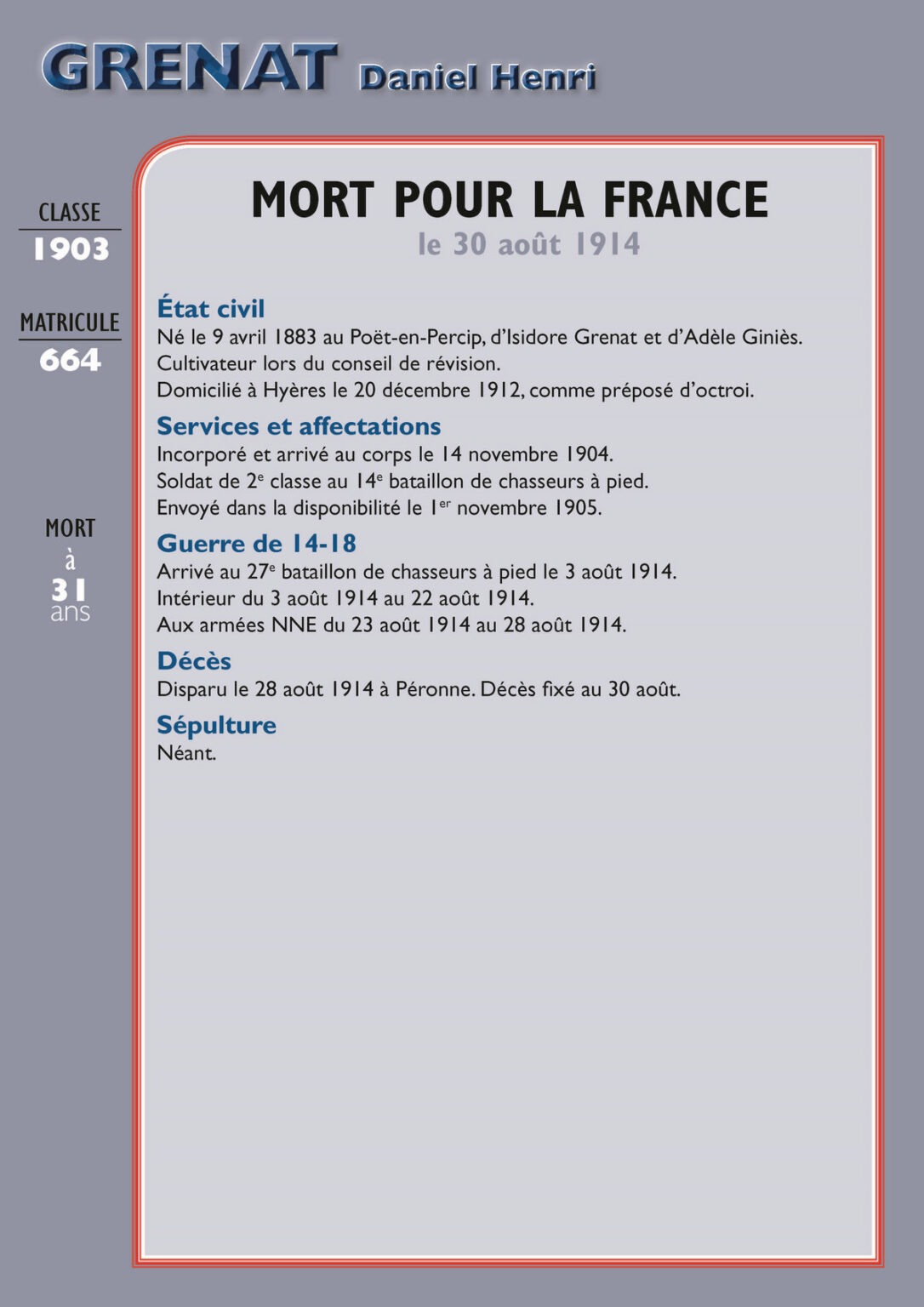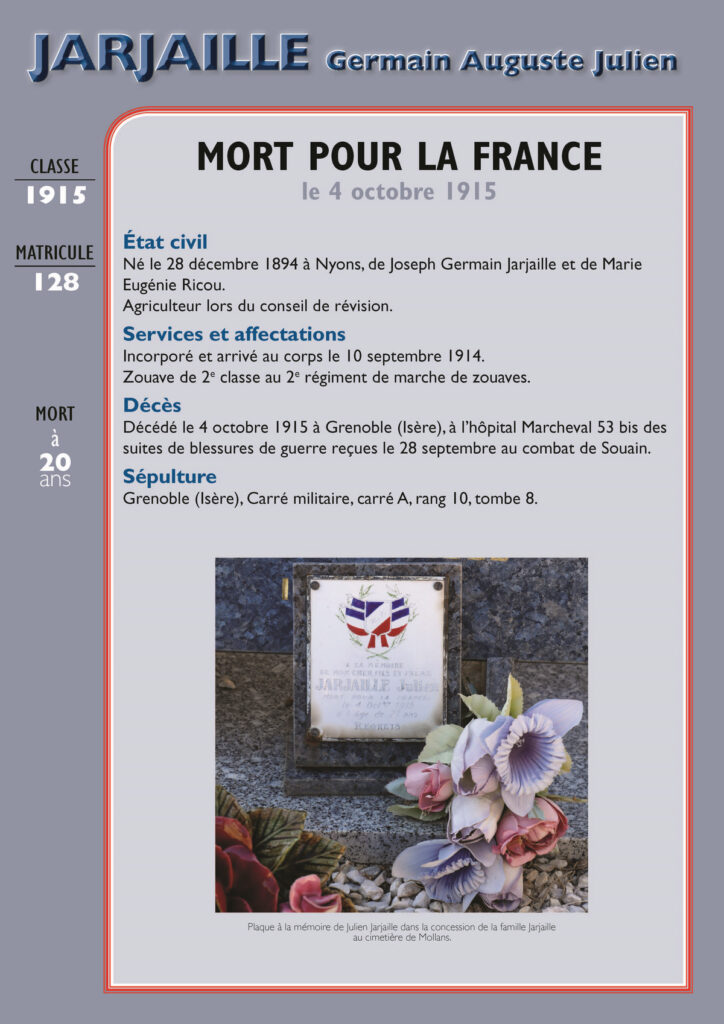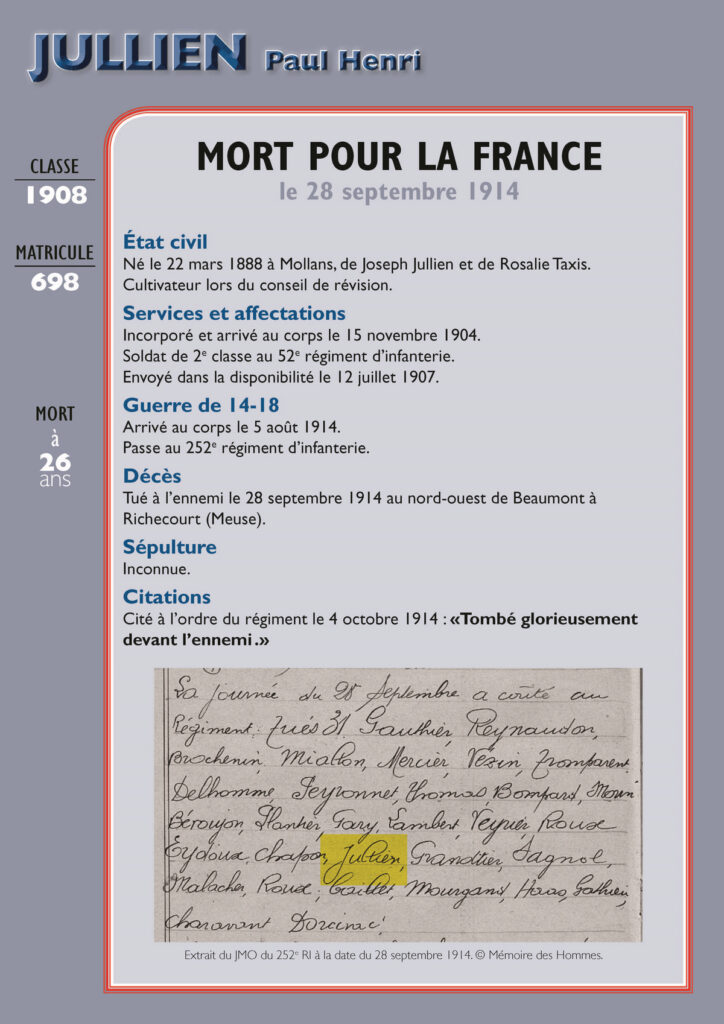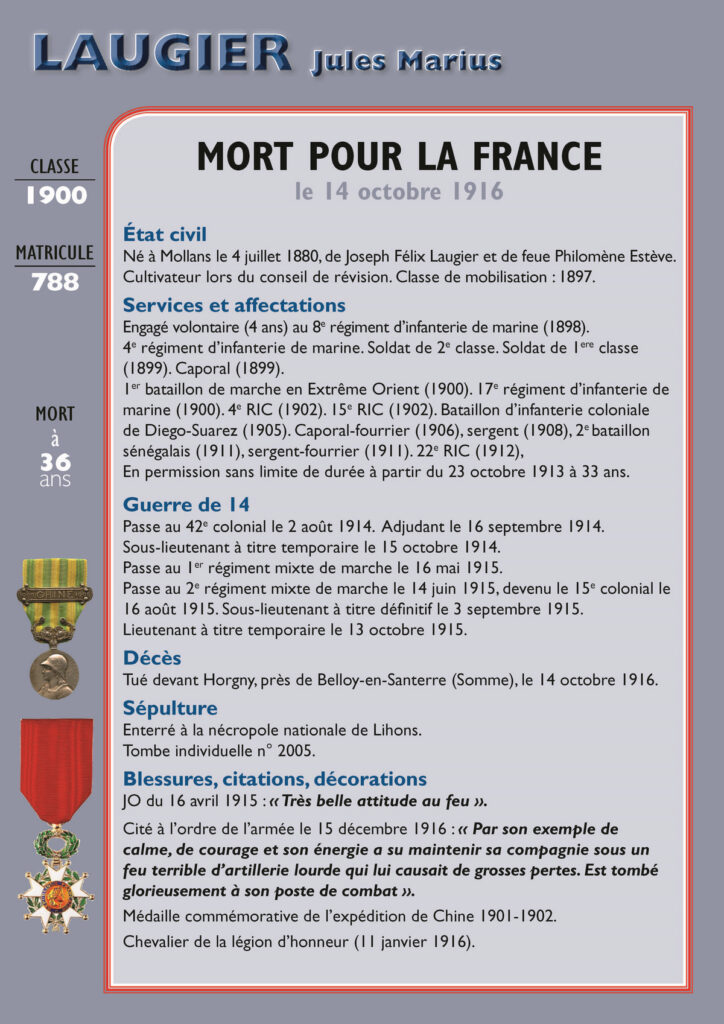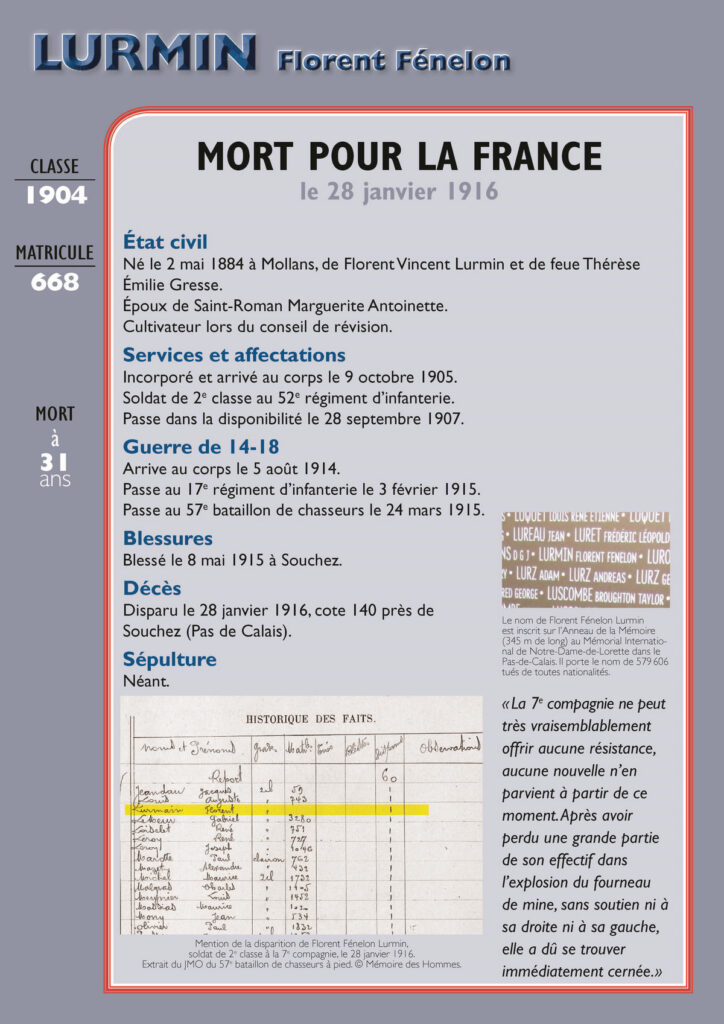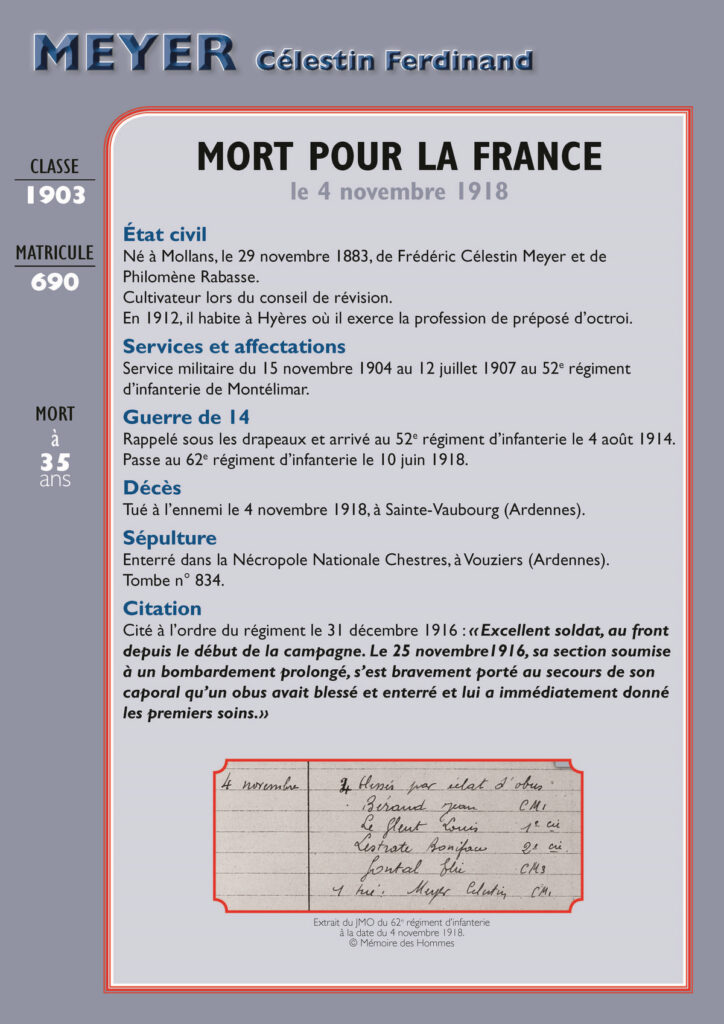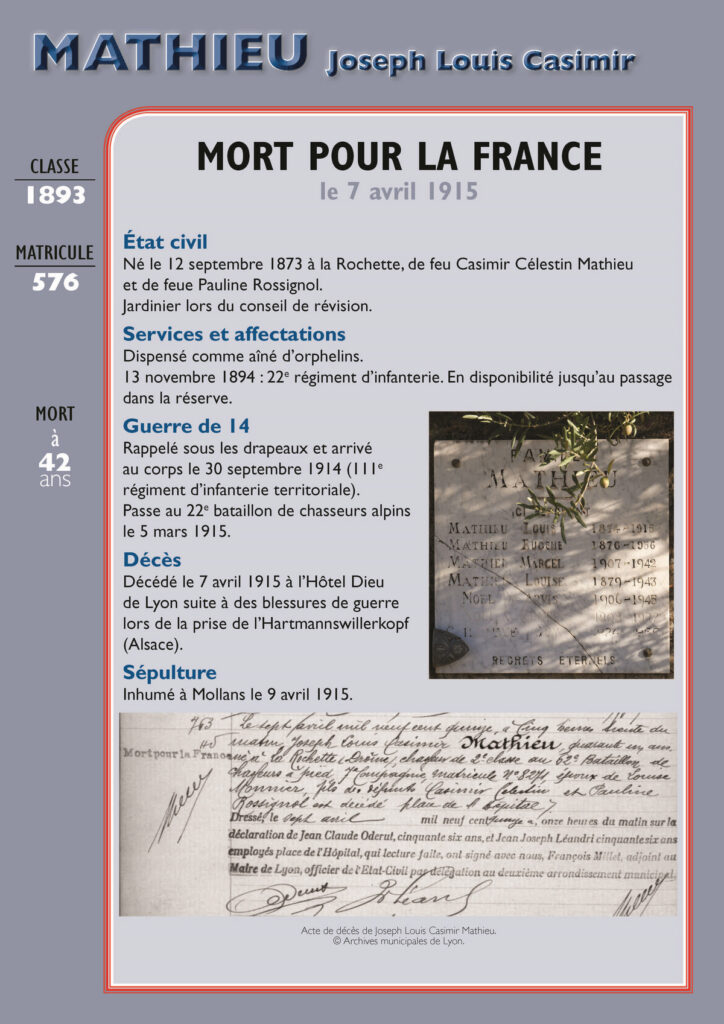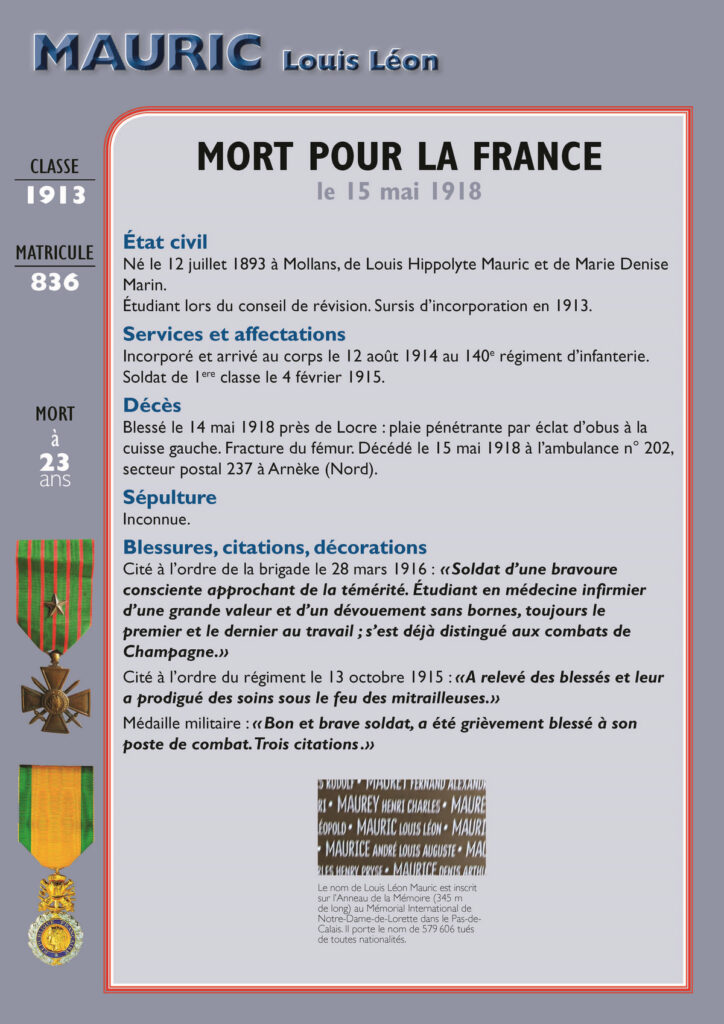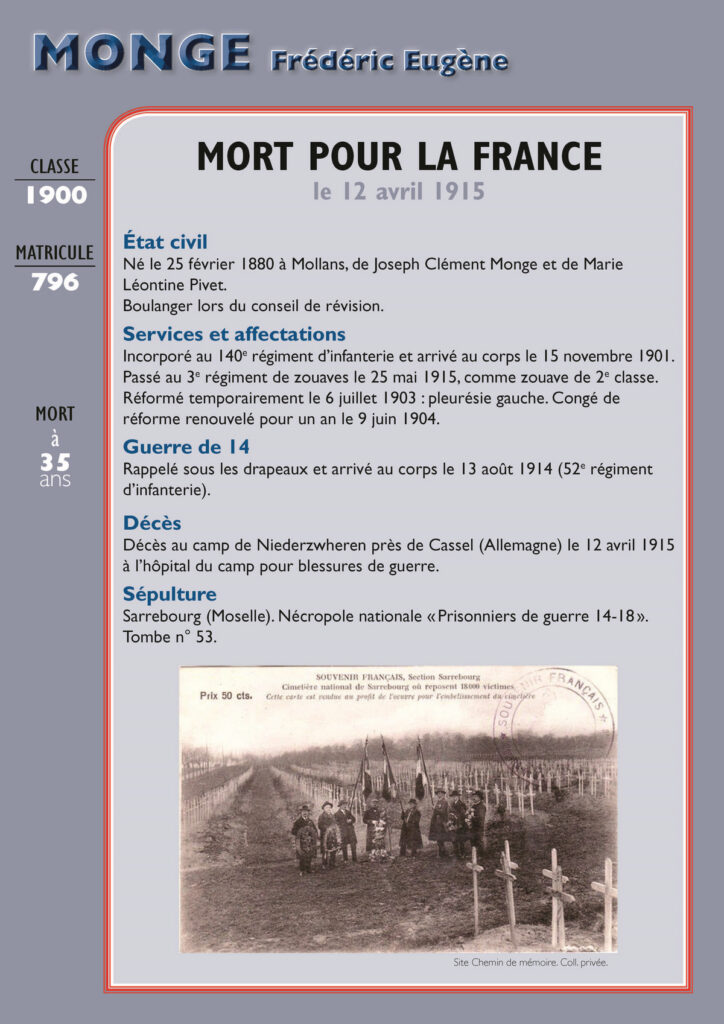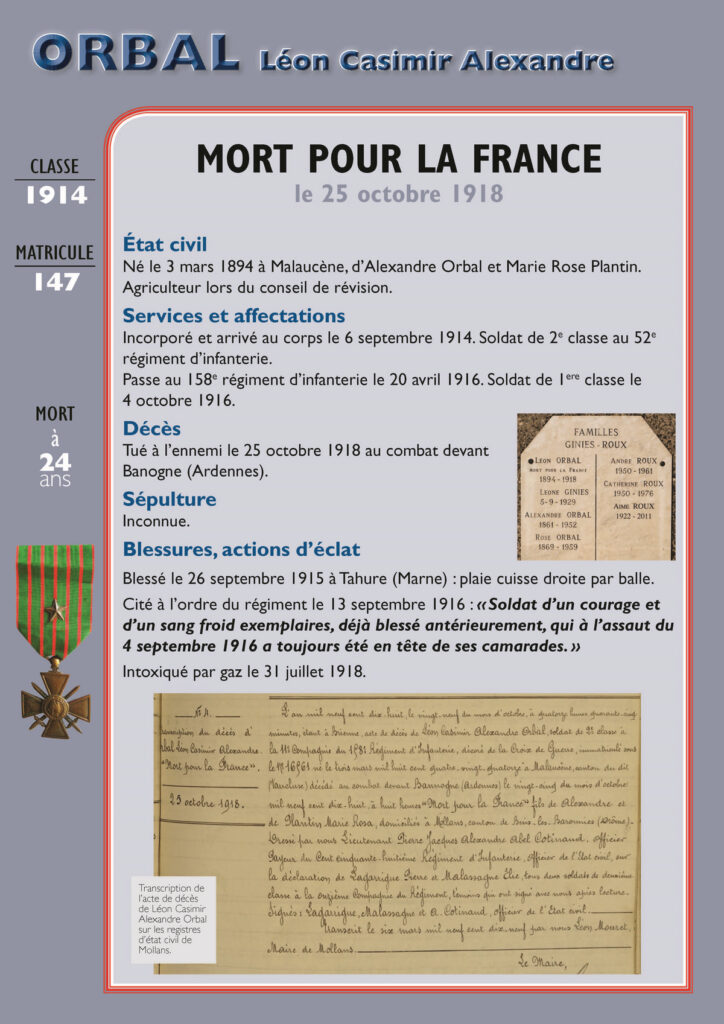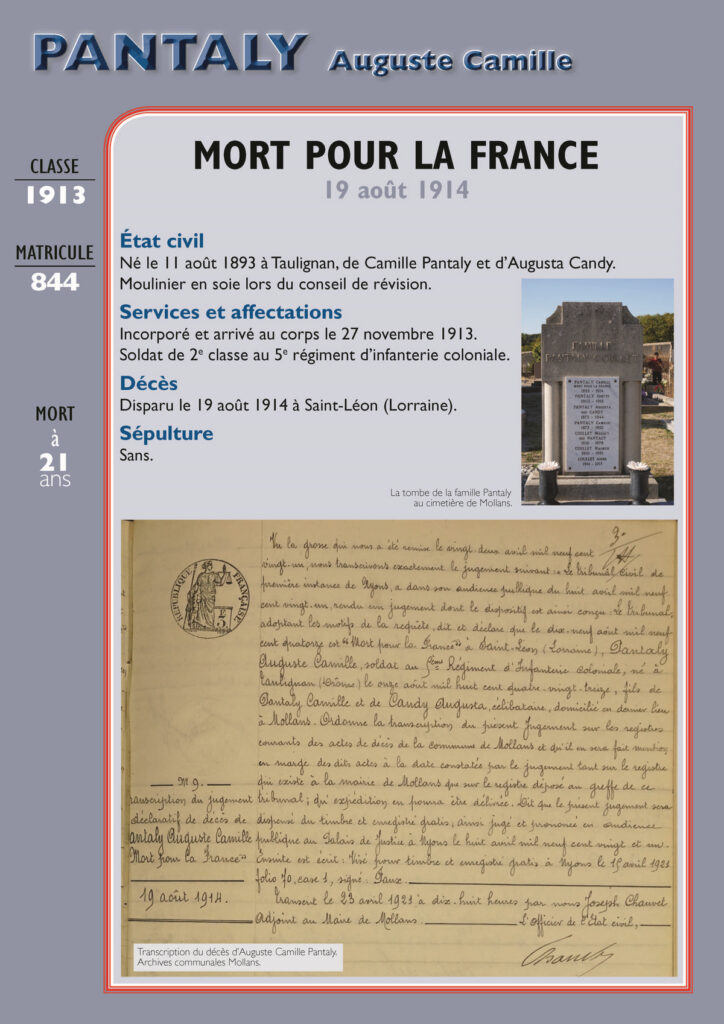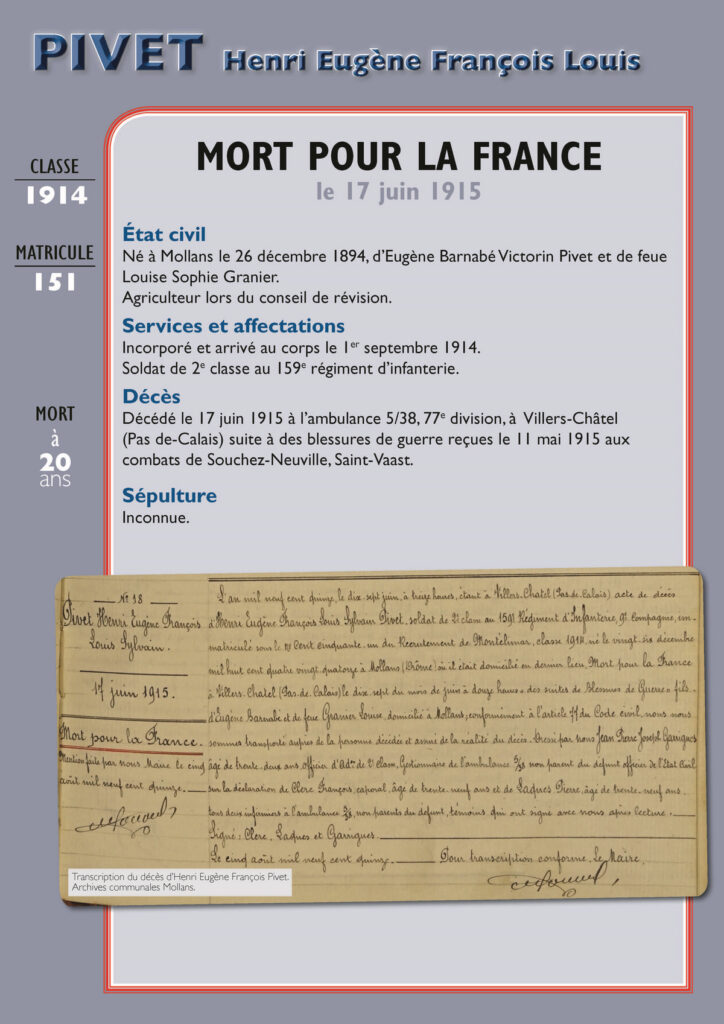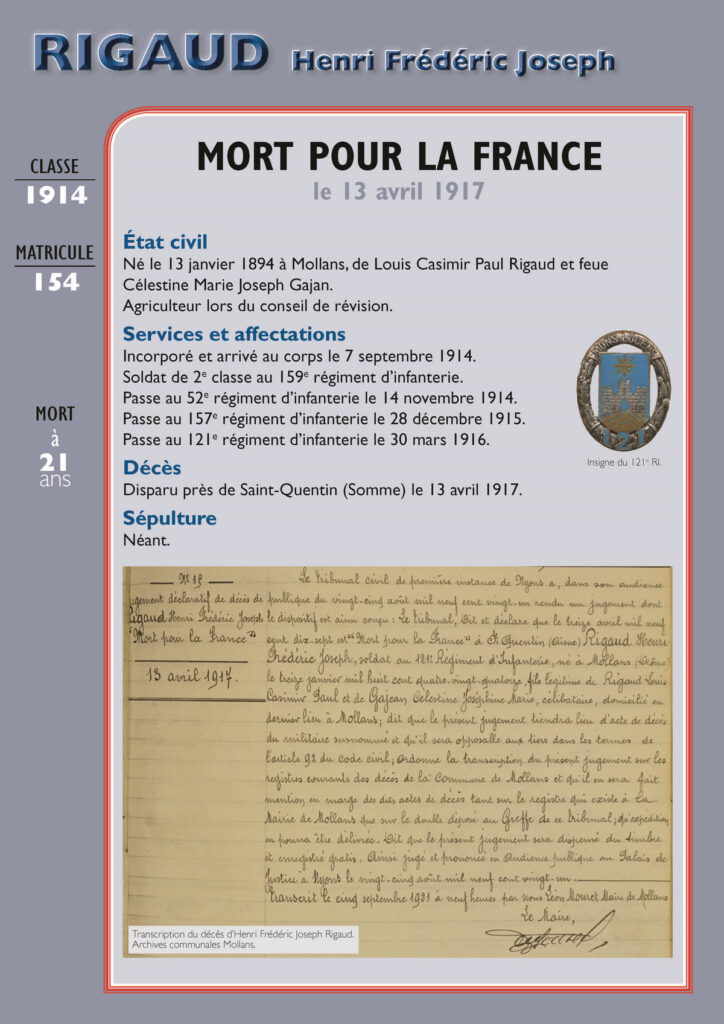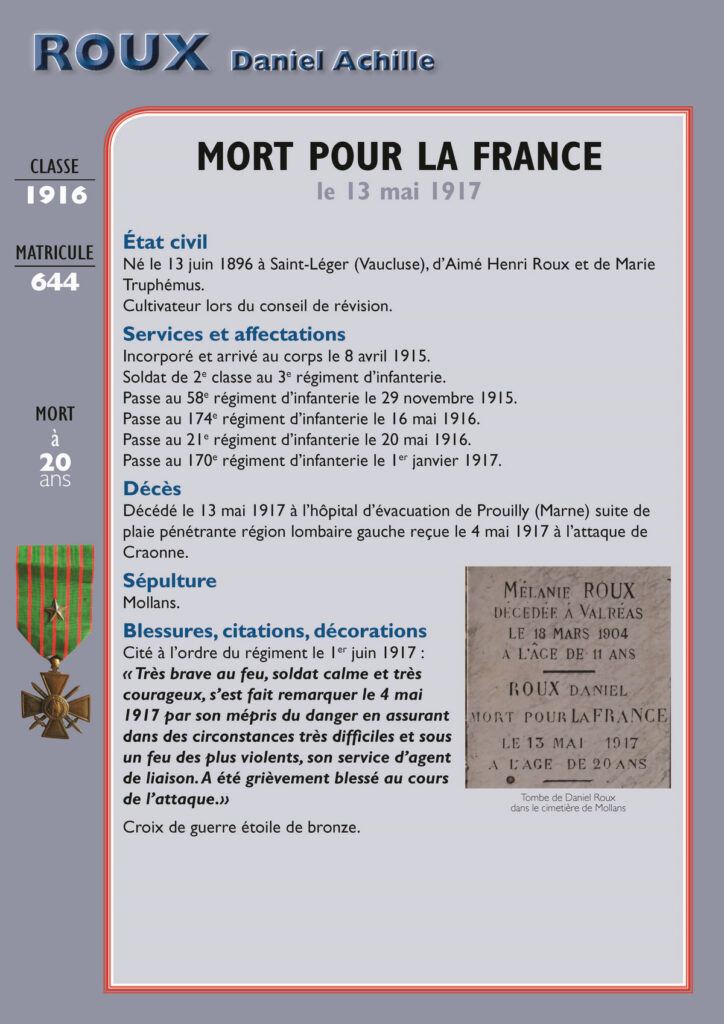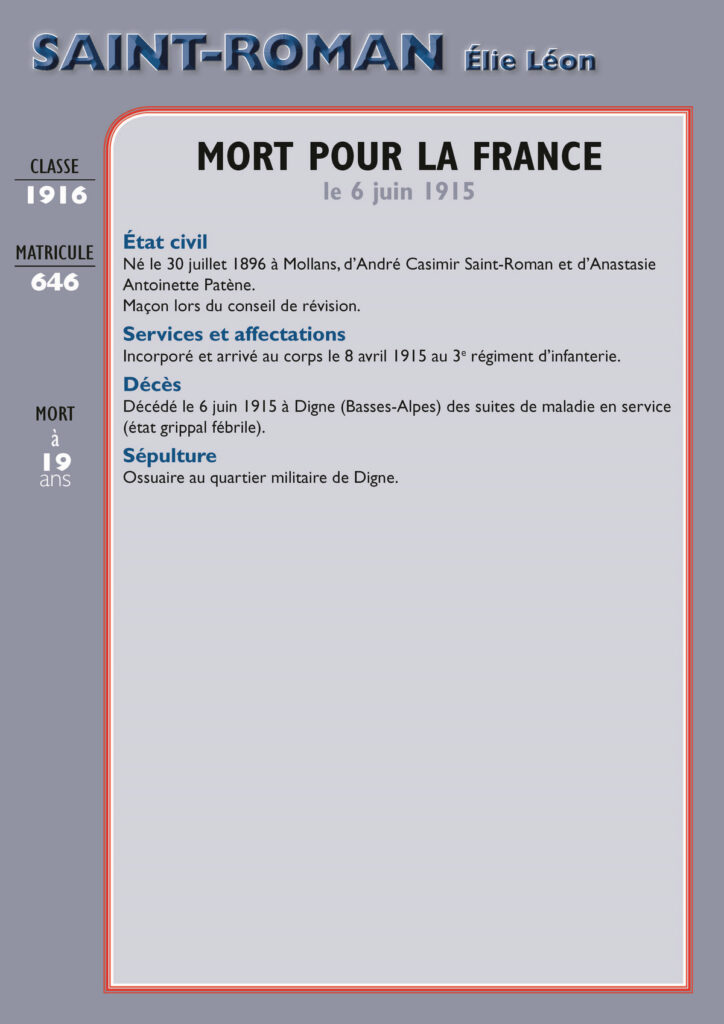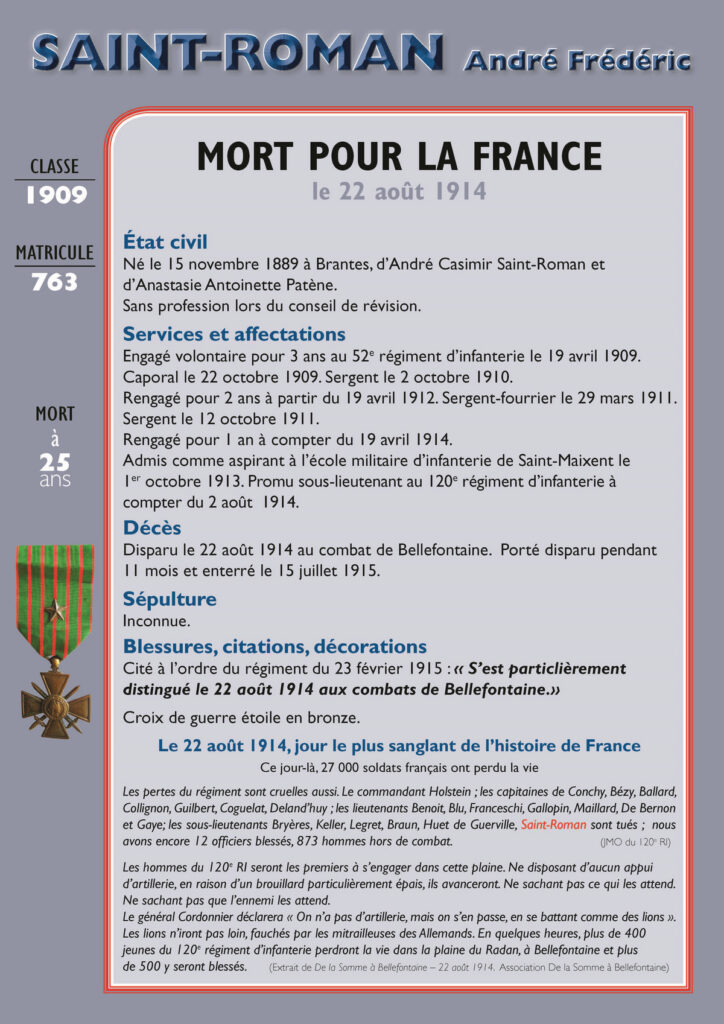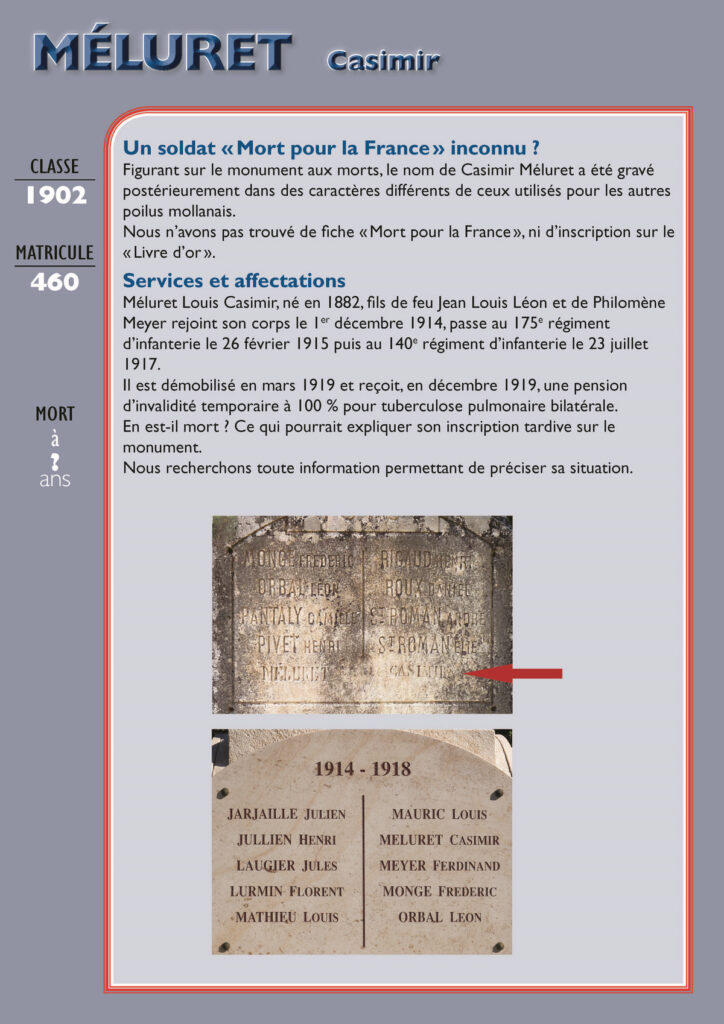La canicule de ce mois de juin m’incite à publier cette belle image de Franz Oort prise en février 2012.
Le réchauffement climatique est-il une réalité ? Mes compétences météorologiques étant nulles, je préfère retrouver dans les archives ce qu’il s’est passé il y a près de 150 ans :
– le 30 juin 1879. il a plu toute la matinée ainsi qu’à l’après goûter. Température douce, la nouvelle neige du Mont Ventoux a entièrement fondu.
– le 11 juin 1881. Gelée blanche qui endommage quelque peu les melons et les haricots.
– 8 et 9 juin 1884. Neige au Mont Ventoux. La campagne séricicole est très contrariée par la pluie et par le froid.
Ces informations climatiques sont tirées du livre de raison de Jean-Joseph Romieu, Mollanais, que nous avait communiqué Graziella Bonnet et que nous avions publié en 2001.
Si ce petit livre vous intéresse… 5 € à demander aux Amis de Mollans, amisdemollans@gmail.com.